"The use of it you may have got from me. But what about the love of it? Where you get the love of it, Tony?"

Méconnu ou mésestimé, y compris dans son pays d'origine, Saddle the Wind vaut bien mieux que la falote réputation dont il est doté. Le second western et dernier des onze films produits par Armand Deutsch possède en effet des particularités aptes à susciter une immédiate curiosité. Il s'agit d'abord du premier authentique(1) scénario signé par Rod Serling
vaut bien mieux que la falote réputation dont il est doté. Le second western et dernier des onze films produits par Armand Deutsch possède en effet des particularités aptes à susciter une immédiate curiosité. Il s'agit d'abord du premier authentique(1) scénario signé par Rod Serling pour le cinéma. Inattendu dans ce registre, le promoteur de la série The Twilight Zone
pour le cinéma. Inattendu dans ce registre, le promoteur de la série The Twilight Zone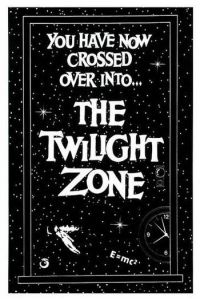 (2), associé pour cette unique occasion à Thomas Thompson (Bonanza
(2), associé pour cette unique occasion à Thomas Thompson (Bonanza ), enchâsse une douloureuse et intéressante étrangeté dans une trame narrative relativement simple. La distribution ensuite se distingue autour du solide Robert Taylor
), enchâsse une douloureuse et intéressante étrangeté dans une trame narrative relativement simple. La distribution ensuite se distingue autour du solide Robert Taylor à l'affiche la même année de The Law and Jake Wade
à l'affiche la même année de The Law and Jake Wade (3) de John Sturges
(3) de John Sturges et du pseudo polar Party Girl
et du pseudo polar Party Girl de Nicholas Ray
de Nicholas Ray .
.
 vaut bien mieux que la falote réputation dont il est doté. Le second western et dernier des onze films produits par Armand Deutsch possède en effet des particularités aptes à susciter une immédiate curiosité. Il s'agit d'abord du premier authentique(1) scénario signé par Rod Serling
vaut bien mieux que la falote réputation dont il est doté. Le second western et dernier des onze films produits par Armand Deutsch possède en effet des particularités aptes à susciter une immédiate curiosité. Il s'agit d'abord du premier authentique(1) scénario signé par Rod Serling pour le cinéma. Inattendu dans ce registre, le promoteur de la série The Twilight Zone
pour le cinéma. Inattendu dans ce registre, le promoteur de la série The Twilight Zone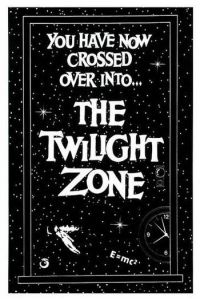 (2), associé pour cette unique occasion à Thomas Thompson (Bonanza
(2), associé pour cette unique occasion à Thomas Thompson (Bonanza ), enchâsse une douloureuse et intéressante étrangeté dans une trame narrative relativement simple. La distribution ensuite se distingue autour du solide Robert Taylor
), enchâsse une douloureuse et intéressante étrangeté dans une trame narrative relativement simple. La distribution ensuite se distingue autour du solide Robert Taylor à l'affiche la même année de The Law and Jake Wade
à l'affiche la même année de The Law and Jake Wade (3) de John Sturges
(3) de John Sturges et du pseudo polar Party Girl
et du pseudo polar Party Girl de Nicholas Ray
de Nicholas Ray .
.
Un individu vindicatif et brutal s'installe dans le saloon encore fermé d'une petite localité. Après s'être approprié le déjeuner de l'un des employés et avoir réclamé à boire, l'homme s'enquiert de Steve Sinclair. Hors-la-loi repenti devenu chef de troupeau de Dennis Deneen puis éleveur grâce à celui-ci, Steve accueille son jeune frère Tony, parti céder à Jeweltown une partie de leur cheptel. Le cadet est accompagnée de Joan Blake, une jeune chanteuse appelée à devenir son épouse. Ce projet et l'acquisition d'un revolver particulièrement affûté n'enthousiasment guère Steve ; il ne cache d'ailleurs pas à Joanie sa désapprobation du mariage envisagé par son frère immature et impulsif qu'il a élevé seul et pour lequel il fait figure de héros. Le lendemain, Steve, Tony, Joanie et deux vachers se rendent en ville. Dans le saloon où ces derniers attendent leur patron, parti déposer à la banque le produit de la vente du bétail, se présente bientôt l'homme à la recherche de Steve. Tony l'interpelle, n'obtient qu'une railleuse indifférence et le provoque en duel. L'attention de son adversaire ayant été détournée par l'arrivée de Steve, Tony abat le nommé Larry Venables, une des plus fines gâchettes selon l'affirmation de son frère.

"Steve! Was Venables faster than you?" La sécheresse de la séquence d'ouverture intrigue d'emblée. Curiosité peu après renforcée par cette surexcitation malsaine qui semble animer Tony Sinclair, elle-même ponctuée par un insolite suicide symbolique. Une espèce d'hystérie frénétique connotant de manière bien plus ambiguës les chaleureuses retrouvailles et relations (lien de dépendance) entre les deux frères. Concis, nerveux, le mal intitulé Saddle the Wind vise en effet moins le lyrisme qu'une terrestre, irrationnelle et funeste compétition fraternelle. Malgré la beauté des paysages naturels du Colorado, le film de Robert Parrish
vise en effet moins le lyrisme qu'une terrestre, irrationnelle et funeste compétition fraternelle. Malgré la beauté des paysages naturels du Colorado, le film de Robert Parrish est étroitement ancré dans une réalité contingente, non idéalisée. Celle où le repentir n'efface pas la culpabilité, où il faut parfois accepter entre deux maux le moindre. La protection en est d'ailleurs le thème principal, lequel évolue et s'enrichit avec l'entrée en scène du personnage du propriétaire nordiste Clay Ellison, figure opposée aux traditionnels fermiers colons des années 1840-60 et carpetbaggers. A l'image de la réalisation de l'ancien figurant et monteur Parrish
est étroitement ancré dans une réalité contingente, non idéalisée. Celle où le repentir n'efface pas la culpabilité, où il faut parfois accepter entre deux maux le moindre. La protection en est d'ailleurs le thème principal, lequel évolue et s'enrichit avec l'entrée en scène du personnage du propriétaire nordiste Clay Ellison, figure opposée aux traditionnels fermiers colons des années 1840-60 et carpetbaggers. A l'image de la réalisation de l'ancien figurant et monteur Parrish (assisté de John Sturges
(assisté de John Sturges ?), Robert Taylor
?), Robert Taylor offre une prestation sobre et efficace, contrastant évidemment avec celle de John Cassavetes
offre une prestation sobre et efficace, contrastant évidemment avec celle de John Cassavetes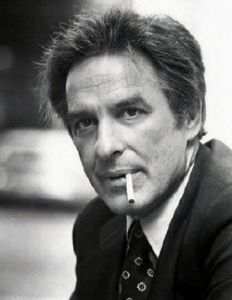 (4). La place dévolue à Julie London
(4). La place dévolue à Julie London , future partenaire de Gary Cooper
, future partenaire de Gary Cooper dans Man of the West
dans Man of the West , apparaît en revanche trop étroite, reléguée à un rôle de soutien parmi ceux tenus notamment par le vétéran Donald Crisp
, apparaît en revanche trop étroite, reléguée à un rôle de soutien parmi ceux tenus notamment par le vétéran Donald Crisp (How Green Was My Valley
(How Green Was My Valley ), Charles McGraw
), Charles McGraw , Royal Dano
, Royal Dano (Bend of the River
(Bend of the River , Johnny Guitar
, Johnny Guitar ) ou Douglas Spencer
) ou Douglas Spencer (Shane
(Shane ...). Saddle the Wind
...). Saddle the Wind mérite vraiment d'être réévalué !
mérite vraiment d'être réévalué !
 vise en effet moins le lyrisme qu'une terrestre, irrationnelle et funeste compétition fraternelle. Malgré la beauté des paysages naturels du Colorado, le film de Robert Parrish
vise en effet moins le lyrisme qu'une terrestre, irrationnelle et funeste compétition fraternelle. Malgré la beauté des paysages naturels du Colorado, le film de Robert Parrish est étroitement ancré dans une réalité contingente, non idéalisée. Celle où le repentir n'efface pas la culpabilité, où il faut parfois accepter entre deux maux le moindre. La protection en est d'ailleurs le thème principal, lequel évolue et s'enrichit avec l'entrée en scène du personnage du propriétaire nordiste Clay Ellison, figure opposée aux traditionnels fermiers colons des années 1840-60 et carpetbaggers. A l'image de la réalisation de l'ancien figurant et monteur Parrish
est étroitement ancré dans une réalité contingente, non idéalisée. Celle où le repentir n'efface pas la culpabilité, où il faut parfois accepter entre deux maux le moindre. La protection en est d'ailleurs le thème principal, lequel évolue et s'enrichit avec l'entrée en scène du personnage du propriétaire nordiste Clay Ellison, figure opposée aux traditionnels fermiers colons des années 1840-60 et carpetbaggers. A l'image de la réalisation de l'ancien figurant et monteur Parrish (assisté de John Sturges
(assisté de John Sturges ?), Robert Taylor
?), Robert Taylor offre une prestation sobre et efficace, contrastant évidemment avec celle de John Cassavetes
offre une prestation sobre et efficace, contrastant évidemment avec celle de John Cassavetes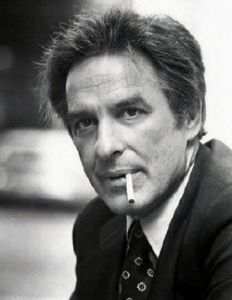 (4). La place dévolue à Julie London
(4). La place dévolue à Julie London , future partenaire de Gary Cooper
, future partenaire de Gary Cooper dans Man of the West
dans Man of the West , apparaît en revanche trop étroite, reléguée à un rôle de soutien parmi ceux tenus notamment par le vétéran Donald Crisp
, apparaît en revanche trop étroite, reléguée à un rôle de soutien parmi ceux tenus notamment par le vétéran Donald Crisp (How Green Was My Valley
(How Green Was My Valley ), Charles McGraw
), Charles McGraw , Royal Dano
, Royal Dano (Bend of the River
(Bend of the River , Johnny Guitar
, Johnny Guitar ) ou Douglas Spencer
) ou Douglas Spencer (Shane
(Shane ...). Saddle the Wind
...). Saddle the Wind mérite vraiment d'être réévalué !
mérite vraiment d'être réévalué !
___
1. celui de Patterns a d'abord été écrit pour la télévision.
a d'abord été écrit pour la télévision.
 a d'abord été écrit pour la télévision.
a d'abord été écrit pour la télévision.
2. ainsi que de la plus tardive et également westernienne The Loner .
.
 .
.
3. où il est un shérif au passé non avoué de bandit.
4. dont Shadows , son premier film en tant que réalisateur, était alors en plein remaniement.
, son premier film en tant que réalisateur, était alors en plein remaniement.
 , son premier film en tant que réalisateur, était alors en plein remaniement.
, son premier film en tant que réalisateur, était alors en plein remaniement. 







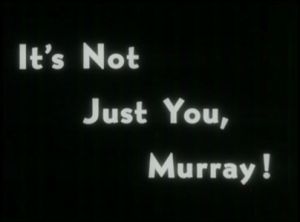 ),
), 
 tient ici le premier de ses huit rôles sous la direction du cinéaste) qui vont caractériser son cinéma jusqu'à la fin des années 1970. Proposé à
tient ici le premier de ses huit rôles sous la direction du cinéaste) qui vont caractériser son cinéma jusqu'à la fin des années 1970. Proposé à 



 .
. de
de  .
.
