"... Nous serons, toi et moi, les plus heureux du monde"
Les films français tirés de polars américains sont rares ; les films
français réussis tirés de polars américains le sont encore davantage. Série noire d'Alain Corneau
d'Alain Corneau est de ceux-là. Bien sûr, le réalisateur a profondément remanié le livre de Jim Thompson
est de ceux-là. Bien sûr, le réalisateur a profondément remanié le livre de Jim Thompson "A Hell of a Woman" (trad. : des cliques et des cloaques), pour l'adapter, avec le concours de l'écrivain et, ici, dialoguiste George Perec
"A Hell of a Woman" (trad. : des cliques et des cloaques), pour l'adapter, avec le concours de l'écrivain et, ici, dialoguiste George Perec , au contexte français. Mais il en a conservé "l'âme".
, au contexte français. Mais il en a conservé "l'âme".
 d'Alain Corneau
d'Alain Corneau est de ceux-là. Bien sûr, le réalisateur a profondément remanié le livre de Jim Thompson
est de ceux-là. Bien sûr, le réalisateur a profondément remanié le livre de Jim Thompson "A Hell of a Woman" (trad. : des cliques et des cloaques), pour l'adapter, avec le concours de l'écrivain et, ici, dialoguiste George Perec
"A Hell of a Woman" (trad. : des cliques et des cloaques), pour l'adapter, avec le concours de l'écrivain et, ici, dialoguiste George Perec , au contexte français. Mais il en a conservé "l'âme".
, au contexte français. Mais il en a conservé "l'âme".
Autant le dire (ou le redire), le film est littéralement porté par Patrick Dewaere ,
étourdissant par ses excès et remarquable par sa sensibilité mal
cachée. Cet acteur avait, en gestation et avec sa propre personnalité,
la puissance d'un Gabin
,
étourdissant par ses excès et remarquable par sa sensibilité mal
cachée. Cet acteur avait, en gestation et avec sa propre personnalité,
la puissance d'un Gabin ou d'un Ventura
ou d'un Ventura .
En minable représentant de commerce déchiré et qui se cherche pour
finalement s'égarer progressivement, perdre pied pour sombrer dans un
monde illusoire, fantasque, il donne au personnage de "Poupée"
une fulgurance de tous les instants. Certains pourraient y voir une
faiblesse, celle d'un acteur en constante "représentation". Mais ce
serait oublier les codes du polar classique : tout n'est que décor
autour du héros (souvent narrateur), y compris ceux qui lui donnent la réplique. De plus, ici, Frank Poupart "se fait, en permanence, son cinéma" (la scène d'ouverture et celle du retour avec le magot sont, de ce point de vue, édifiantes).
.
En minable représentant de commerce déchiré et qui se cherche pour
finalement s'égarer progressivement, perdre pied pour sombrer dans un
monde illusoire, fantasque, il donne au personnage de "Poupée"
une fulgurance de tous les instants. Certains pourraient y voir une
faiblesse, celle d'un acteur en constante "représentation". Mais ce
serait oublier les codes du polar classique : tout n'est que décor
autour du héros (souvent narrateur), y compris ceux qui lui donnent la réplique. De plus, ici, Frank Poupart "se fait, en permanence, son cinéma" (la scène d'ouverture et celle du retour avec le magot sont, de ce point de vue, édifiantes).
 ,
étourdissant par ses excès et remarquable par sa sensibilité mal
cachée. Cet acteur avait, en gestation et avec sa propre personnalité,
la puissance d'un Gabin
,
étourdissant par ses excès et remarquable par sa sensibilité mal
cachée. Cet acteur avait, en gestation et avec sa propre personnalité,
la puissance d'un Gabin ou d'un Ventura
ou d'un Ventura .
En minable représentant de commerce déchiré et qui se cherche pour
finalement s'égarer progressivement, perdre pied pour sombrer dans un
monde illusoire, fantasque, il donne au personnage de "Poupée"
une fulgurance de tous les instants. Certains pourraient y voir une
faiblesse, celle d'un acteur en constante "représentation". Mais ce
serait oublier les codes du polar classique : tout n'est que décor
autour du héros (souvent narrateur), y compris ceux qui lui donnent la réplique. De plus, ici, Frank Poupart "se fait, en permanence, son cinéma" (la scène d'ouverture et celle du retour avec le magot sont, de ce point de vue, édifiantes).
.
En minable représentant de commerce déchiré et qui se cherche pour
finalement s'égarer progressivement, perdre pied pour sombrer dans un
monde illusoire, fantasque, il donne au personnage de "Poupée"
une fulgurance de tous les instants. Certains pourraient y voir une
faiblesse, celle d'un acteur en constante "représentation". Mais ce
serait oublier les codes du polar classique : tout n'est que décor
autour du héros (souvent narrateur), y compris ceux qui lui donnent la réplique. De plus, ici, Frank Poupart "se fait, en permanence, son cinéma" (la scène d'ouverture et celle du retour avec le magot sont, de ce point de vue, édifiantes).
Les confrontations avec Bernard Blier sont tout bonnement exquises. Tout les oppose (pas seulement dans le film) et les réunit à la fois : la génération, le tempérament, le jeu dans une complémentarité quasi parfaite. Marie Trintignant
sont tout bonnement exquises. Tout les oppose (pas seulement dans le film) et les réunit à la fois : la génération, le tempérament, le jeu dans une complémentarité quasi parfaite. Marie Trintignant , pour son premier film (si l'on ne tient pas compte de ceux tournés avec sa mère, Nadine)
joue une adolescente quasi autiste à travers laquelle la frontière
entre réalité et fiction, raison et folie devient floue, insaisissable.
, pour son premier film (si l'on ne tient pas compte de ceux tournés avec sa mère, Nadine)
joue une adolescente quasi autiste à travers laquelle la frontière
entre réalité et fiction, raison et folie devient floue, insaisissable.
 sont tout bonnement exquises. Tout les oppose (pas seulement dans le film) et les réunit à la fois : la génération, le tempérament, le jeu dans une complémentarité quasi parfaite. Marie Trintignant
sont tout bonnement exquises. Tout les oppose (pas seulement dans le film) et les réunit à la fois : la génération, le tempérament, le jeu dans une complémentarité quasi parfaite. Marie Trintignant , pour son premier film (si l'on ne tient pas compte de ceux tournés avec sa mère, Nadine)
joue une adolescente quasi autiste à travers laquelle la frontière
entre réalité et fiction, raison et folie devient floue, insaisissable.
, pour son premier film (si l'on ne tient pas compte de ceux tournés avec sa mère, Nadine)
joue une adolescente quasi autiste à travers laquelle la frontière
entre réalité et fiction, raison et folie devient floue, insaisissable.
Enfin, l'absence de musique écrite pour ce film donne à Série noire un caractère singulier. Alain Corneau
un caractère singulier. Alain Corneau a choisi, comme Scorsese
a choisi, comme Scorsese dans Mean Streets
dans Mean Streets , de ponctuer son film de chansons d'époque (Dalida, Sheila, Claude François, Lenorman, Boney M) ou du "Moonlight Fiesta" de Duke Ellington
, de ponctuer son film de chansons d'époque (Dalida, Sheila, Claude François, Lenorman, Boney M) ou du "Moonlight Fiesta" de Duke Ellington . A noter que la phrase de titre, sensée appartenir à la chanson de G. Bécaud "Le jour où la pluie viendra", est une pure invention de Frank Poupart... Un rêve (cauchemar) éveillé.
. A noter que la phrase de titre, sensée appartenir à la chanson de G. Bécaud "Le jour où la pluie viendra", est une pure invention de Frank Poupart... Un rêve (cauchemar) éveillé.
 un caractère singulier. Alain Corneau
un caractère singulier. Alain Corneau a choisi, comme Scorsese
a choisi, comme Scorsese dans Mean Streets
dans Mean Streets , de ponctuer son film de chansons d'époque (Dalida, Sheila, Claude François, Lenorman, Boney M) ou du "Moonlight Fiesta" de Duke Ellington
, de ponctuer son film de chansons d'époque (Dalida, Sheila, Claude François, Lenorman, Boney M) ou du "Moonlight Fiesta" de Duke Ellington . A noter que la phrase de titre, sensée appartenir à la chanson de G. Bécaud "Le jour où la pluie viendra", est une pure invention de Frank Poupart... Un rêve (cauchemar) éveillé.
. A noter que la phrase de titre, sensée appartenir à la chanson de G. Bécaud "Le jour où la pluie viendra", est une pure invention de Frank Poupart... Un rêve (cauchemar) éveillé.














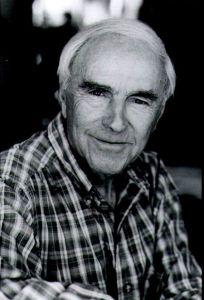














 a créé
a créé  ),
le film se déroule dans le Vienne de l'après-guerre, la ville découpée
en zones alliées (américaine, anglaise, française, russe autour d'une
zone internationale) portant les cicatrices des combats récents.
),
le film se déroule dans le Vienne de l'après-guerre, la ville découpée
en zones alliées (américaine, anglaise, française, russe autour d'une
zone internationale) portant les cicatrices des combats récents. 






