"J'avais oublié à quoi je ressemblais."
Certains
lieux sont des décors spontanés de tragédies. L'Afghanistan est de
ceux-là. Mainte fois occupé depuis l'Antiquité, son histoire est
particulièrement mouvementée. A partir de 1973, année qui mettait fin à
quarante ans d'une rare stabilité dans le pays, ce carrefour de l'Asie
Centrale est le théâtre de conflits avec l'étranger et de luttes
intestines. Le kaboulais naturalisé français Atiq Rahimi pouvait-il trouver meilleur cadre (si l'on peut dire) pour son premier film, adaptation de son roman publié en 2000 ? Produit par Dimitri de Clercq et parrainé par Bernard-Henri Lévy (l'association n'a rien d'étonnant puisque, outre Serbie, année zéro, de Clercq apparaît également au générique de plusieurs films avec Arielle Dombasle
pouvait-il trouver meilleur cadre (si l'on peut dire) pour son premier film, adaptation de son roman publié en 2000 ? Produit par Dimitri de Clercq et parrainé par Bernard-Henri Lévy (l'association n'a rien d'étonnant puisque, outre Serbie, année zéro, de Clercq apparaît également au générique de plusieurs films avec Arielle Dombasle ), l'intéressant Khakestar-o-khak
), l'intéressant Khakestar-o-khak , après Osama
, après Osama ,
permet au cinéma afghan d'être à nouveau présent au plan international.
Il avait d'ailleurs été choisi par son pays pour être son représentant
aux "Oscars" 2004 dans la catégorie "meilleur film étranger" (sa candidature n'avait finalement pas été retenue par l'A.M.P.A.S.). Sélectionné à Cannes l'année dernière dans la section "Un Certain regard", il a reçu le prix "Regard vers l'avenir" décerné à un premier long métrage.
,
permet au cinéma afghan d'être à nouveau présent au plan international.
Il avait d'ailleurs été choisi par son pays pour être son représentant
aux "Oscars" 2004 dans la catégorie "meilleur film étranger" (sa candidature n'avait finalement pas été retenue par l'A.M.P.A.S.). Sélectionné à Cannes l'année dernière dans la section "Un Certain regard", il a reçu le prix "Regard vers l'avenir" décerné à un premier long métrage.
 pouvait-il trouver meilleur cadre (si l'on peut dire) pour son premier film, adaptation de son roman publié en 2000 ? Produit par Dimitri de Clercq et parrainé par Bernard-Henri Lévy (l'association n'a rien d'étonnant puisque, outre Serbie, année zéro, de Clercq apparaît également au générique de plusieurs films avec Arielle Dombasle
pouvait-il trouver meilleur cadre (si l'on peut dire) pour son premier film, adaptation de son roman publié en 2000 ? Produit par Dimitri de Clercq et parrainé par Bernard-Henri Lévy (l'association n'a rien d'étonnant puisque, outre Serbie, année zéro, de Clercq apparaît également au générique de plusieurs films avec Arielle Dombasle ), l'intéressant Khakestar-o-khak
), l'intéressant Khakestar-o-khak , après Osama
, après Osama ,
permet au cinéma afghan d'être à nouveau présent au plan international.
Il avait d'ailleurs été choisi par son pays pour être son représentant
aux "Oscars" 2004 dans la catégorie "meilleur film étranger" (sa candidature n'avait finalement pas été retenue par l'A.M.P.A.S.). Sélectionné à Cannes l'année dernière dans la section "Un Certain regard", il a reçu le prix "Regard vers l'avenir" décerné à un premier long métrage.
,
permet au cinéma afghan d'être à nouveau présent au plan international.
Il avait d'ailleurs été choisi par son pays pour être son représentant
aux "Oscars" 2004 dans la catégorie "meilleur film étranger" (sa candidature n'avait finalement pas été retenue par l'A.M.P.A.S.). Sélectionné à Cannes l'année dernière dans la section "Un Certain regard", il a reçu le prix "Regard vers l'avenir" décerné à un premier long métrage.
Après le bombardement d'Abqol, son village, et la perte de la presque totalité de sa famille, Dastaguir et son petit-fils Yassin,
devenu sourd par les explosions, se rendent par la route sur un pont au
dessus d'une rivière asséchée, lieu de jonction leur permettant d'aller
vers la mine où travaille Mourad, le fils du vieil homme et le
père du jeune garçon. Ayant raté le camion qui doit les y conduire, ils
vont à Tchel Sarâ également en grande partie détruit. Amro, le père de Zaynab , la bru de Dastaguir,
vient d'enterrer tous les siens. De retour sur le pont fréquenté par un
oiseux et irascible garde-barrière, un marchand de fruits philosophe et
une mère et sa fille s'abritant à l'ombre d'un tank détruit, Dastaguir attend le prochain passage du camion tout en redoutant d'annoncer la terrible nouvelle dont il est porteur à son fils.
Dans sa grande épuration (terme ô combien délicat) et son apparente simplicité, le film d'Atiq Rahimi est une œuvre forte et touchante. Probablement parce que le malheur vécu par Dastaguir,
au delà de sa dimension métaphorique du drame afghan, a une portée
universelle. Il est d'ailleurs étrange de constater à quel point ce
naturaliste, cette pureté lui confère une certaine abstraction. Récit,
hélas, élémentaire dans un contexte qui ne l'est pas, belle parabole sur
l'absence et la perte, Khakestar-o-khak
est une œuvre forte et touchante. Probablement parce que le malheur vécu par Dastaguir,
au delà de sa dimension métaphorique du drame afghan, a une portée
universelle. Il est d'ailleurs étrange de constater à quel point ce
naturaliste, cette pureté lui confère une certaine abstraction. Récit,
hélas, élémentaire dans un contexte qui ne l'est pas, belle parabole sur
l'absence et la perte, Khakestar-o-khak ne doit pas, semble-t-il, être regardé comme une production exotique
porteuse d'un message politique localisé. C'est l'Homme et ses
générations (voir le mythe de Rostam et de son fils Sohrab) qui sont au centre du film, pas moins. Soulignons la jolie variation sur le couple surdité-mutisme (avec cette image des voix volées par les chars), la belle photographie d'Eric Guichard
ne doit pas, semble-t-il, être regardé comme une production exotique
porteuse d'un message politique localisé. C'est l'Homme et ses
générations (voir le mythe de Rostam et de son fils Sohrab) qui sont au centre du film, pas moins. Soulignons la jolie variation sur le couple surdité-mutisme (avec cette image des voix volées par les chars), la belle photographie d'Eric Guichard (Latcho Drom, Les Diables
(Latcho Drom, Les Diables ) et la solide prestation d'acteurs non-professionnels parmi lesquels celle de l'étonnant jeune Jawan Mard et celle d'Abdul Ghani, décédé après le tournage.
) et la solide prestation d'acteurs non-professionnels parmi lesquels celle de l'étonnant jeune Jawan Mard et celle d'Abdul Ghani, décédé après le tournage.
 est une œuvre forte et touchante. Probablement parce que le malheur vécu par Dastaguir,
au delà de sa dimension métaphorique du drame afghan, a une portée
universelle. Il est d'ailleurs étrange de constater à quel point ce
naturaliste, cette pureté lui confère une certaine abstraction. Récit,
hélas, élémentaire dans un contexte qui ne l'est pas, belle parabole sur
l'absence et la perte, Khakestar-o-khak
est une œuvre forte et touchante. Probablement parce que le malheur vécu par Dastaguir,
au delà de sa dimension métaphorique du drame afghan, a une portée
universelle. Il est d'ailleurs étrange de constater à quel point ce
naturaliste, cette pureté lui confère une certaine abstraction. Récit,
hélas, élémentaire dans un contexte qui ne l'est pas, belle parabole sur
l'absence et la perte, Khakestar-o-khak ne doit pas, semble-t-il, être regardé comme une production exotique
porteuse d'un message politique localisé. C'est l'Homme et ses
générations (voir le mythe de Rostam et de son fils Sohrab) qui sont au centre du film, pas moins. Soulignons la jolie variation sur le couple surdité-mutisme (avec cette image des voix volées par les chars), la belle photographie d'Eric Guichard
ne doit pas, semble-t-il, être regardé comme une production exotique
porteuse d'un message politique localisé. C'est l'Homme et ses
générations (voir le mythe de Rostam et de son fils Sohrab) qui sont au centre du film, pas moins. Soulignons la jolie variation sur le couple surdité-mutisme (avec cette image des voix volées par les chars), la belle photographie d'Eric Guichard (Latcho Drom, Les Diables
(Latcho Drom, Les Diables ) et la solide prestation d'acteurs non-professionnels parmi lesquels celle de l'étonnant jeune Jawan Mard et celle d'Abdul Ghani, décédé après le tournage.
) et la solide prestation d'acteurs non-professionnels parmi lesquels celle de l'étonnant jeune Jawan Mard et celle d'Abdul Ghani, décédé après le tournage. 












 ) et
) et 







 ) qui emportent l'adhésion. Quant à
) qui emportent l'adhésion. Quant à 









 ),
voire absurdes, soit dans le traitement original du film, l'utilisation
de longues focales qui nous place au plus près des protagonistes, le
peu de soin apparent accordé au cadrage ou à l'image, soit encore dans
la prestation des acteurs.
),
voire absurdes, soit dans le traitement original du film, l'utilisation
de longues focales qui nous place au plus près des protagonistes, le
peu de soin apparent accordé au cadrage ou à l'image, soit encore dans
la prestation des acteurs.




 ),
), 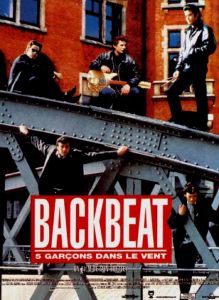




 et
et  ) et Pauline Sutcliffe (la jeune sœur de Stu), le film de
) et Pauline Sutcliffe (la jeune sœur de Stu), le film de 



